Logements vacants : quel impact sur le marché locatif ?
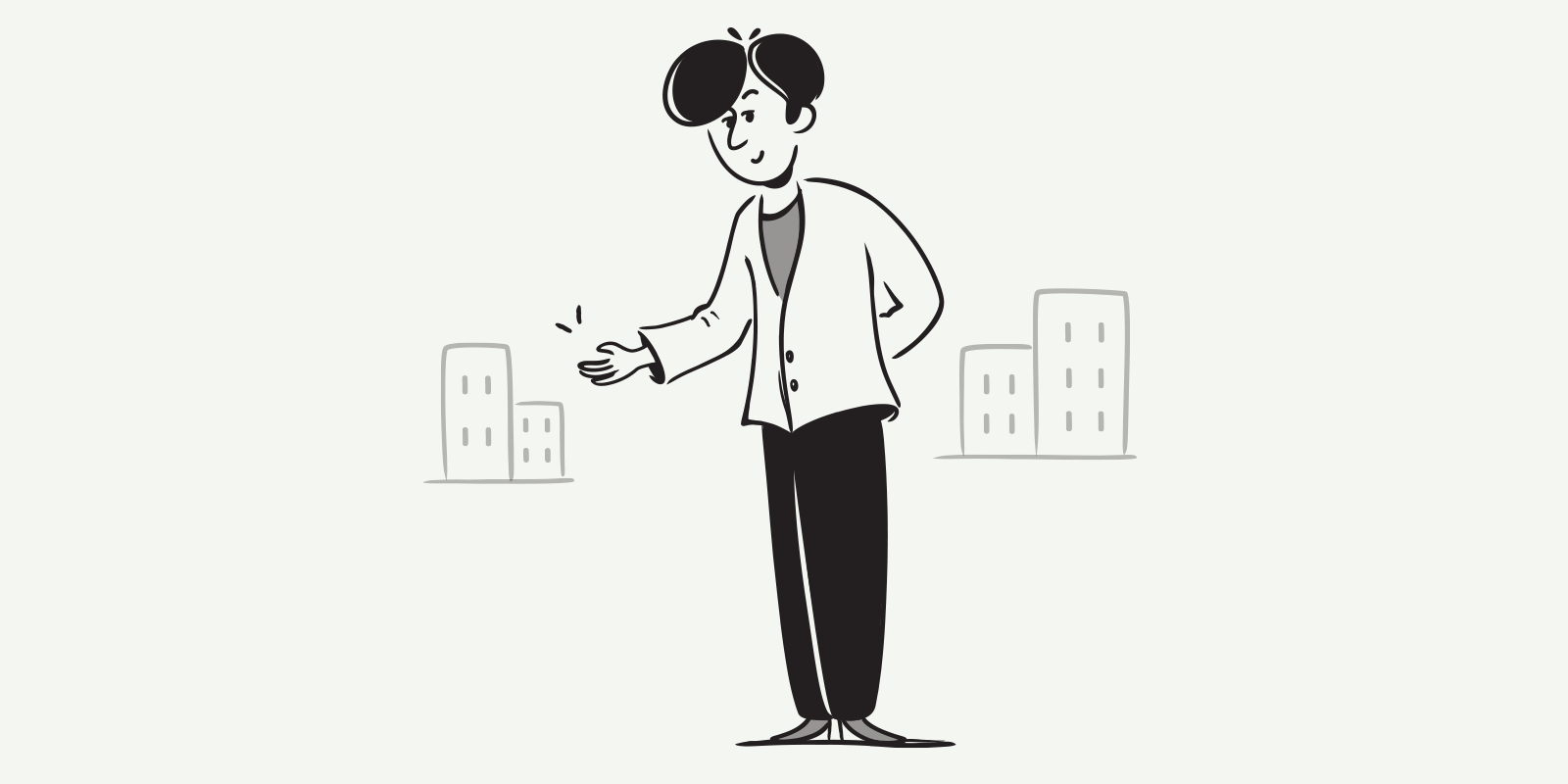
- État des lieux des logements vacants en France
- Pourquoi un logement reste-t-il vide ? Les causes principales !
- Une évolution en lien avec les dynamiques du marché
- Logements vacants : les conséquences sur le marché locatif
- Pourquoi autant de logements restent vacants ?
- Comment réduire la vacance des logements ?
- Quelles stratégies mettre en place par les propriétaires ?
- Quelles stratégies mettre en place par les propriétaires ?
- FAQs
- Points à retenir
Plus de trois millions de logements sont aujourd’hui vacants en France. Un chiffre qui interroge, alors même que se loger devient un véritable défi, dans les grandes villes comme dans les zones rurales.
L’offre se réduit, les loyers flambent, et les tensions s’intensifient. Alors pourquoi autant de logements vacants ? Quelles sont les conséquences sur le marché locatif ? Quelles solutions sont mises en place ? On fait le point !
État des lieux des logements vacants en France
Selon une étude Insee parue en janvier 2024, la France compte environ 3,1 millions de logements vacants, soit 8,2 % du parc total. En effet, depuis 2005, le nombre de logements vacants progresse en moyenne de 2,5 % par an.
Contrairement aux idées reçues, les logements vacants ne se concentrent pas dans les grandes villes. Ce sont les zones rurales et les petites villes qui affichent les taux de vacance les plus élevés, à savoir :
- Le taux moyen de vacance atteint 9,6 % dans les communes de moins de 50 000 habitants.
- Dans les grandes agglomérations de plus de 700 000 habitants, il tombe à 7 %, un niveau proche de la vacance dite « frictionnelle » (logements temporairement vides entre deux baux ou ventes).
Certaines régions sont nettement plus touchées que d’autres par la vacance locative. C’est le cas de départements comme la Creuse, la Nièvre, les Ardennes, le Cher, l’Indre ou encore les Vosges, où le taux dépasse les 11 %.
À l’inverse, les zones attractives comme le littoral atlantique, les Alpes ou l’Île-de-France affichent des taux de vacance inférieurs à la moyenne. À Paris, par exemple, on recensait environ 128 000 logements vacants en 2020, soit 9,2 % du parc. Mais seuls 18 600 d’entre eux étaient inoccupés depuis plus de deux ans.
Pourquoi un logement reste-t-il vide ? Les causes principales !
Selon l’Insee, un logement vacant, est un bien inoccupé et disponible. Les raisons de cette vacance sont multiples, à savoir :
- Biens invendables ou inadaptés : certains logements, souvent anciens, exigus, peu confortables ou mal situés, sont aujourd’hui considérés comme hors marché. Les causes sont souvent une vétusté importante, des surfaces trop réduites ou une conception devenue obsolète. Pour les remettre en location, il faut engager des travaux lourds, souvent trop onéreux pour des propriétaires qui n’en ont ni les moyens ni l’intérêt économique.
- Succession ou indivision : environ 20 % des logements vacants le sont en raison d’un décès ou d’une succession bloquée. En cas de conflit entre héritiers, ou de mise sous tutelle, le bien peut rester vide pendant des années.
- Vacance pour travaux : certains logements sont temporairement inoccupés pendant des rénovations. Ces cas relèvent de la vacance de court terme, mais viennent gonfler les chiffres.
- Rétention : certains logements sont volontairement laissés vides par leur propriétaire pour des raisons qui relèvent d’une stratégie personnelle ou patrimoniale. Par exemple, ils peuvent souhaiter conserver le bien pour un usage futur (loger un enfant, préparer sa retraite) ou attendre une hausse des prix dans une logique spéculative.
- Désintérêt locatif : certains propriétaires préfèrent tout simplement ne pas louer. Derrière cette décision, on retrouve des craintes liées aux aléas de la location (impayés, dégradations, procédures judiciaires, gestion chronophage…). Sans oublier la complexité administrative et fiscale qui peut décourager, notamment les propriétaires les plus âgés. Parfois ils préfèrent renoncer à louer en raison d’une rentabilité jugée trop faible face aux contraintes.
Souvent, plusieurs facteurs se cumulent. Par exemple, un appartement énergivore hérité récemment, situé dans une commune peu dynamique, peut facilement rester vide plusieurs années faute d’entretien ou de décision collective.
C’est ce qu’on appelle la vacance structurelle, qui concerne aujourd’hui environ 1,2 million de logements, soit un tiers des logements vacants. Ces biens pourraient représenter un levier majeur pour renforcer l’offre locative, à condition de lever les freins qui les maintiennent hors marché.
Une évolution en lien avec les dynamiques du marché
Depuis 2005, la vacance a progressé de près de 50 %, portée dans un premier temps par la construction massive de logements, parfois mal localisés ou mal adaptés à la demande. Si la tendance s’est ralentie après 2017, elle reste présente.
Aujourd’hui, la conjoncture économique freine la remise sur le marché de nombreux biens, en raison de la hausse des taux d’intérêt, des coûts de rénovation élevés et des exigences environnementales renforcées. Certains logements restent ainsi durablement inoccupés, notamment dans les zones peu dynamiques où la rentabilité locative n’est plus assurée.
Ce décalage entre offre et demande souligne les limites d’un modèle fondé uniquement sur la construction neuve, et renforce la nécessité de valoriser l’existant.
Logements vacants : les conséquences sur le marché locatif
La vacance immobilière ne se limite pas à un simple chiffre. En effet, ses répercussions se font sentir sur l’ensemble du marché locatif, en particulier dans les zones tendues.
Réduction de l’offre locative dans les zones tendues
Dans les territoires où la demande locative est déjà supérieure à l’offre, chaque logement laissé vide accentue le déséquilibre. En 2022, on recensait plus de 118 000 logements privés vacants depuis plus de deux ans, y compris en centre-ville ou près des bassins d’emploi. Cette situation freine l’accès au logement pour les étudiants, les jeunes actifs ou les familles modestes.
Des loyers sous tension dans les grandes villes
Moins de biens à louer, c’est aussi plus de concurrence… et des loyers qui grimpent. En 2024, le loyer moyen a augmenté de 3,3 % pour atteindre 723 € par mois (charges comprises), bien au-delà de l’inflation. Mais ce chiffre masque d’importants écarts.
Par exemple, en Île-de-France, les loyers au m² sont 78 % plus élevés que dans le reste du pays, et à Paris, l’écart dépasse 160 %. Le manque d’offre contribue directement à cette flambée.
Une offre locative en net recul
Entre 2021 et 2023, le nombre de biens disponibles à la location a chuté de 29 % à l’échelle nationale. Résultat ? Chaque annonce suscite une forte concurrence.
En région parisienne, le nombre de candidats par bien a bondi de 71 % en un an. Dans des villes comme Lyon ou Bordeaux, les files d’attente pour une visite sont devenues la norme, et certaines agences reçoivent même des propositions de surloyer.
Une mobilité bloquée
La rareté de l’offre n’impacte pas uniquement les loyers. Elle paralyse aussi la mobilité résidentielle. De plus en plus de locataires renoncent à déménager, de peur de ne pas retrouver un logement équivalent. Ceux qui envisagent d’acheter se retrouvent également bloqués par la hausse des taux d’intérêt, les empêchant de sortir du parc locatif.
Les témoignages abondent : des mois de recherche infructueuse, des logements indécents loués à prix d’or, ou des situations précaires acceptées par défaut. Cette spirale n’est pas uniquement liée à la vacance, mais chaque logement durablement vide participe à l’asphyxie du marché.
À l’inverse, leur retour sur le marché permettrait de fluidifier les parcours résidentiels et de rééquilibrer la pression locative.
Pourquoi autant de logements restent vacants ?
Derrière l’augmentation des logements vacants, plusieurs facteurs se conjuguent comme les nouvelles normes énergétiques, la fiscalité ou encore la complexité de la gestion locative. Tour d’horizon des freins qui poussent certains propriétaires à laisser leur bien vide.
Le poids des nouvelles obligations réglementaires
Le renforcement des exigences énergétiques continue de bouleverser le marché locatif. Pour éliminer progressivement les passoires thermiques, un calendrier d’interdiction de location a été mis en place. Après les logements classés G+, c’est désormais l’ensemble des logements classés G qui ne peuvent plus être loués. Et dès 2028, ce sera au tour des biens classés F.
On estime à plus de 1,6 million l’ensemble des logements F et G. Sans rénovation, ces biens sont voués à sortir du marché, aggravant mécaniquement la vacance dite « technique ».
Si l’ambition écologique est incontestable, le risque à court terme est bien réel. Une part importante du parc locatif va devenir inutilisable, faute de travaux engagés.
Une fiscalité peu incitative
La fiscalité actuelle n’encourage pas non plus à louer durablement. La location nue, pourtant essentielle pour répondre à la demande de logements pérennes, est souvent moins avantageuse fiscalement que la location meublée ou saisonnière. Ce déséquilibre entre régimes crée un biais dans les stratégies d’investissement, au détriment du parc locatif classique.
À cela s’ajoute l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui ne tient pas compte des dettes ou des efforts de rénovation engagés. Le sentiment d’injustice est renforcé par la comparaison avec les placements financiers, souvent moins taxés malgré des rendements similaires. Dans ce contexte, la fiscalité devient un frein supplémentaire pour les investisseurs qui préfèrent se tourner vers d’autres placements.
Les débats autour du projet de loi de finances 2026 témoignent d’une prise de conscience progressive, avec des propositions pour rééquilibrer les régimes fiscaux. Mais tant que ces mesures ne seront pas concrètement mises en œuvre, une part significative du parc immobilier restera à l’écart du marché locatif.
Des rénovations coûteuses
L’état du logement constitue l’un des principaux freins à sa remise sur le marché. De nombreux biens vacants sont vétustes, mal isolés ou non conformes aux normes actuelles. Leur réhabilitation implique souvent des travaux lourds (isolation, rénovation intérieure, électricité, assainissement…). Même avec les aides publiques comme MaPrimeRénov’ ou les subventions de l’Anah, le reste à charge peut vite atteindre des sommes conséquentes.
Ce frein est encore plus marqué dans les zones où les prix de l’immobilier sont faibles. Dans ces territoires, la rentabilité d’une remise en location est souvent insuffisante pour justifier l’investissement. Dans ce contexte, beaucoup de gens renoncent à investir… ou laissent leur bien tout simplement vide.
Une gestion locative chronophage
Louer un logement implique bien plus que la simple perception de loyers.
Diagnostics obligatoires, encadrement des loyers, déclarations fiscales complexes, risque d’impayés, la difficulté d’expulser un locataire de mauvaise foi, hausse continue de la taxe foncière… autant de contraintes qui peuvent rapidement décourager les propriétaires. Pour les petits bailleurs, ou ceux qui ne résident pas à proximité du bien, la location devient parfois plus source de stress que d’opportunité.
Comment réduire la vacance des logements ?
Pour endiguer la vacance locative, pouvoirs publics, collectivités et propriétaires cherchent des leviers pour remettre ces logements sur le marché.
Une fiscalité dissuasive… mais à l’efficacité relative
Afin d’inciter les propriétaires à mettre en location leur bien, deux taxes s’appliquent aux logements vacants, à savoir :
- La taxe sur les logements vacants (TLV), réservée aux zones tendues : depuis 2023, elle s’étend à plus de 2 260 communes, avec un taux pouvant atteindre 25 % de la valeur locative dès la deuxième année d’inoccupation.
- La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) : instaurée par les communes hors zones tendues. Elle est aujourd’hui appliquée dans plus de 6 400 communes.
Entre 2017 et 2024, le nombre de logements taxés a presque doublé, atteignant près de 810 000 biens pour 271 millions d’euros de recettes.
Mais l’impact reste limité. En effet, selon la Cour des comptes, ces taxes n’ont pas entraîné de baisse significative de la vacance. De nombreux propriétaires préfèrent les payer plutôt que de louer dans des conditions peu rentables ou d’investir dans des travaux lourds.
Encourager la rénovation avec des aides et incitations financières
Plusieurs dispositifs ont été maintenus ou renforcés pour encourager les bailleurs et investisseurs à entreprendre des travaux de rénovation, à savoir :
- Les aides de l’Anah : elles financent une partie des travaux de rénovation dans l’ancien, en échange d’un engagement de location à loyer modéré. Ce soutien concerne notamment les biens insalubres ou très vétustes.
- La prime de sortie de vacance : lancée en 2024, elle propose une aide de 5 000 euros aux propriétaires qui remettent sur le marché un logement vacant depuis plus de deux ans, en zone rurale. Pour en bénéficier, il faut réaliser des travaux avec l’Anah et s’engager à louer le bien pendant au moins six ans.
- Le dispositif Loc’Avantages : il permet d’obtenir une réduction d’impôt en signant une convention avec l’Anah pour louer à un loyer inférieur au marché. Entre 2017 et 2022, ce mécanisme a permis de mobiliser près de 40 000 logements.
- La loi Denormandie : prolongé jusqu’en 2027, le dispositif vise les logements anciens à rénover dans des communes éligibles. Il offre une réduction d’impôt calculée sur le coût global de l’opération (achat + travaux), à condition de louer le bien rénové comme résidence principale pendant 6, 9 ou 12 ans, avec un avantage fiscal de 12 %, 18 % ou 21 %.
L’implication croissante des collectivités locales
Plusieurs communes se mobilisent pour lutter contre la vacance, en combinant accompagnement local et outils opérationnels :
- Des programmes nationaux de soutien, comme Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain ou encore le plan Logement d’abord, permettent de réhabiliter des logements vacants pour répondre aux besoins locaux, notamment en faveur des publics précaires.
- La plateforme Zéro Logement Vacant, déployée sur certains territoires, identifie les logements vides ou énergivores à partir des données fiscales et des diagnostics DPE. Elle facilite ensuite l’envoi de courriers ciblés aux propriétaires pour leur présenter les aides à la rénovation disponibles, les dispositifs d’intermédiation locative ou la possibilité de confier leur bien à une agence immobilière sociale.
- Des actions spécifiques mises en œuvre par certaines communes, comme la surtaxe de la taxe d’habitation (+60 % à Paris), la création de guichets uniques pour centraliser l’information, le portage foncier temporaire via des opérateurs publics…
- La réquisition de logements vacants, bien que très rare, reste une mesure symbolique pouvant inciter certains propriétaires à remettre leur bien sur le marché pour éviter des contraintes plus lourdes.
Quelles stratégies mettre en place par les propriétaires ?
Outre les dispositifs de défiscalisation vus précédemment, sortir un logement de la vacance demande parfois un simple changement de stratégie, comme :
- La location meublée : le statut LMNP bénéficie d’une fiscalité plus avantageuse que la location nue. Il ouvre droit, au régime micro-BIC avec un abattement de 50 % sur les recettes locatives, et au régime réel. Ce dernier permet grâce à son mécanisme d’amortissement de réduire, voire d’annuler l’imposition. En revanche, ce type de location implique une gestion plus rigoureuse et une comptabilité plus encadrée.
- La colocation, intéressante pour les grands logements anciens mal adaptés à la demande familiale actuelle.
- L’intermédiation locative, via une association ou un bail glissant, permet de sécuriser les revenus sans subir les aléas de la gestion.
- La revente à un investisseur, une solution pertinente quand le propriétaire ne souhaite pas engager les travaux lui-même.
- Sécuriser la location : en souscrivant une assurance loyers impayés et en déléguant la gestion locative pour plus de sérénité.
Quelles perspectives pour le marché locatif face à la vacance ?
Face à la pénurie de logements et aux défis environnementaux, les logements vacants représentent un levier d’action désormais incontournable.
Une pression croissante pour mobiliser les logements vacants
Les pouvoirs publics renforcent leur stratégie pour remettre ces logements sur le marché, à travers :
- Des objectifs écologiques clairs, comme la lutte contre l’artificialisation des sols. Rénover un logement vide est moins coûteux, moins polluant et plus rapide que construire un logement neuf.
- Un encadrement législatif renforcé, avec des mesures prises pour limiter les locations meublées de tourisme (type Airbnb) et mieux réguler les résidences secondaires dans les zones tendues.
Bon à savoir!
L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) milite pour un dispositif fiscal universel qui remplacerait les régimes actuels, jugés complexes et inéquitables. Les premières mesures devraient être intégrées dans la proposition de loi de finances pour 2026.
Les nouvelles normes énergétiques : frein ou opportunité ?
À court terme, l’interdiction progressive de louer des passoires thermiques (logements classés F ou G) pourrait faire augmenter la vacance. Mais à moyen terme, cela pourrait surtout accélérer la rénovation du parc locatif.
Les logements visés par ces interdictions représentent une réserve d’opportunités pour les bailleurs et les artisans du bâtiment. Des aides comme MaPrimeRénov’ ont été mises en place pour accompagner ces travaux. Toutefois, il faut noter une pause temporaire du dispositif pour les rénovations globales :
- Depuis le 23 juin 2025, les dossiers pour des rénovations lourdes sont suspendus jusqu’à mi-septembre, le temps de mieux encadrer les demandes et éviter les abus.
- Les aides pour les travaux simples (monogestes) comme l’isolation d’un mur ou le remplacement d’une chaudière restent ouvertes pour le moment.
Cette pause ne remet pas en cause l’objectif de long terme qui est de remettre sur le marché des logements rénovés, décents, et performants sur le plan énergétique.
Un marché favorable aux investisseurs
Pour les investisseurs, les logements vacants présentent plusieurs atouts :
- Des prix décotés, notamment dans l’ancien dégradé.
- Des incitations fiscales comme la loi Denormandie ou Loc’Avantages.
- Des loyers en hausse, particulièrement dans les zones tendues, ce qui améliore les rendements.
En choisissant bien leur secteur et en s’appuyant sur les aides existantes, les investisseurs peuvent transformer un bien inoccupé en un actif rentable, tout en répondant à une demande réelle.
FAQs
Quel est l’impact de la réduction de l’offre sur le marché locatif ?
La baisse de l’offre locative, notamment dans les zones tendues, entraîne une hausse des loyers, une saturation des annonces, et une mobilité résidentielle plus difficile. Elle pénalise particulièrement les étudiants, les jeunes actifs et les ménages modestes.
Qu’est-ce qu’un logement vacant ?
Il s’agit d’un logement inoccupé, non meublé, disponible à la vente ou à la location… ou laissé vide pour d’autres raisons. Un logement est considéré comme vacant durablement lorsqu’il reste inoccupé depuis plus de deux ans.
Mon logement est vide depuis plusieurs mois. Suis-je concerné par une taxe ?
Oui. Si votre bien est vacant depuis plus d’un an, vous pouvez être soumis à la taxe sur les logements vacants (TLV) ou à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), selon la commune où il se situe.
Louer un bien ancien vaut-il encore le coup avec toutes les nouvelles normes ?
Cela dépend. Les nouvelles normes énergétiques rendent certains biens interdits à la location sans travaux. Mais des aides comme MaPrimeRénov’ ou Loc’Avantages peuvent rendre la rénovation rentable et faciliter la remise en location.
Logements vacants en France : Les points à retenir
- Plus de 3 millions de logements sont vacants en France représentant 8,2 % du parc de logements en 2023.
- La vacance est liée à plusieurs facteurs : vétusté des biens, coûts de rénovation élevés, normes énergétiques plus strictes, déséquilibres territoriaux, fiscalité dissuasive ou gestion locative complexe.
- Dans les zones tendues, ces logements inoccupés aggravent la crise : raréfaction de l’offre, hausse des loyers, blocage de la mobilité résidentielle.
- Depuis 2023, la réglementation interdit progressivement la location des passoires thermiques, accentuant la vacance technique.
- Des dispositifs existent pour relancer le marché : subventions de l’Anah, prime de sortie de vacance, fiscalité avantageuse avec Loc’Avantages ou Denormandie.
- Les collectivités locales s’impliquent via des programmes comme Action Cœur de Ville ou la plateforme Zéro Logement Vacant.
- L’UNPI propose un statut bailleur privé afin d’unifier et simplifier la fiscalité.
